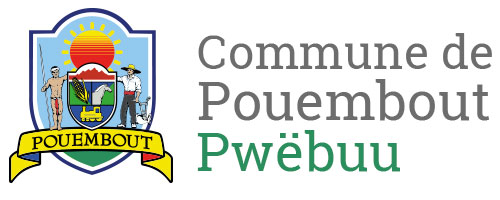Découvrir Pouembout
Un village mélanésien appelé WABUN, où résidaient les clans NIANDUN et PWEBU, aurait existé avant l’arrivée européenne.
Ce dernier a donné son nom au village. Ces clans se sont établis sur la côte Est, mais l’époque de leur départ n’est pas connue.Leur succèderont des clans originaires de la vallée de la Tchamba qui, ayant migré sur la côte Ouest durant la 2e moitié du XVIIIe siècle, vont étendre leur égémonie sur le secteur de Koné et Pouembout.
Ce qui n’était au départ qu’un centre de colonisation pénale…
Après la révolte de 1878, la construction du fort militaire et l’ouverture du centre de colonisation libre de Koné sont décidées.
En 1883, la grande plaine alluvionnaire de Pouembout fut choisie par le gouverneur Pallu De La Barrière pour y établir un centre de colonisation
pénale destiné aux « ouvriers de la transportation » méritants. Une annexe s’ouvrira à
Koniambo un an plus tard. L’objectif est que la colonisation libre puisse bénéficier de la
colonisation pénale (ouverture des routes et infrastructures) et qu’à long terme les deux
colonisations fusionnent.
Les conditions de mise en valeur des concessions sont strictes et beaucoup de
concessionnaires seront dépossédés de leur lot. Ceux qui ont su s’adapter, s’accrocher et survivre, parfois rejoints par leur famille où ayant trouvé une épouse dans la colonie vont y faire souche. Ces colons forcés seront en partie à l’origine des familles pionnières de Pouembout.
Sur leur lot de 4 ha, les familles doivent tendre à l’autosuffisance de par le peu de revenus que dégagent leurs cultures. Le petit élevage (volailles et porcs) ainsi que le maraîchage assurent la subsistance. Les productions essentielles seront : le maïs, les haricots, le café, le tabac, le manioc. Sécheresses persistantes et inondations rythment la vie.

Propriété agricole de la famille ESPIES (1939)
De grandes propriétés d’élevage, attribuées à des colons libres, entourent le centre.
À partir de 1910, les premiers essais de coton sont concluants. Pouembout va devenir un centre important de cette culture.
Au début du XXe siècle, les mines de cobalt de Tiéa vont donner du travail jusqu’en 1910.
Les mines de Kopéto deviendront le second pôle d’emploi dans cette commune à vocation agropastorale.
Les tribus de Paouta, Koweï, Tiaoué, Poaloa et Sibou sont les seuls villages mélanésiens signalés à cette époque.
La répression qui suivra la révolte de Koné de 1917, va modifier durablement le nombre et l’emplacement des villages et tribus de la Haute Pouembout.
Une municipalité
Depuis 1911, Pouembout est devenu une municipalité de 385 habitants. La population de ce petit village de brousse avec sa mairie-école, la poste, quelques commerces, un poste de gendarmerie, et un local de culte, atteint 750 habitants en 1930.

La pomme de terre, la pastèque, le maraîchage deviennent des cultures importantes.
L’eau courante sera pour 1947, l’électricité pour 1968.
La voie de communication maritime reste la plus régulière et la plus sûre. Le sentier muletierest surtout utilisé par les conduites de bétail. La route ne sera ouverte qu’en 1932.
La première école indigène laïque du secteur ouvre à Paouta. Les deux tribus Koweï et Paouta vont se regrouper et développer la culture du café.
Les mines de Kopéto ferment. C’est alors l’exploitation du gypse, utilisé pour le procédé de fonte du minerai de nickel. À la mine Edison on extrait du cuivre aurifère. La société des Mines Franco est déclarée en 1938. Elle exploitera le chrome alluvionnaire pendant 10 ans.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’aérodrome de la Plaine des Gaïacs va être le
plus important aérodrome du pays pendant 18 mois. Avec de larges dégagements sur le lagon il pouvait accueillir 40 gros quadrimoteurs B-17 ou B-25.
Le secteur Pouembout/Népoui va constituer une agglomération de 7 à 9000 personnes. Un mémorial a été érigé depuis sur la colline qui domine les anciennes pistes.
La culture du blé relancée depuis 1947 est développée avec la mécanisation. Tout comme le maïs. La pomme de terre, la pastèque, le maraîchage deviennent des cultures importantes.
Une partie des travailleurs engagés asiatiques sont restés. Ils ont acheté une propriété, ou sont devenus métayers ou simplement employés en tant que résidents libres. L’élevage devient plus rentable. Les tiques, héritage des Américains, doivent être combattues. La piscine municipale sera construite.
La mine reste la deuxième source de revenus. Tiébaghi embauche au début des années 50, Calmet sur la presqu’île de Pindaï ne durera pas longtemps. Puis le centre SLN de Népoui/Kopéto va ouvrir.
La pêche du troca et de la biche de mer fait vivre quelques-uns. Souvent il faut avoir plusieurs débouchés pour joindre les deux bouts. On est polyvalent et opportuniste pour gagner sa vie.
Aujourd’hui la commune de 674,3 km² et compte 2591 habitants. La tribu de Paouta et celle de Ouaté sont situées dans le périmètre communal.
Le Plan d’Urbanisme directeur, de nouveaux lotissements, des infrastructures publiques sont dus à la mise en œuvre du schéma de développement de la zone VKP. De l’augmentation de la population découle l’accroissement des emplois dans le secteur privé. Mais la vocation agropastorale de Pouembout demeure bien ancrée.
C’est d’ailleurs cette commune qui accueille le seul Lycée Agricole publique du pays.
Sources : Mémoire de maîtrise « La colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie : l’exemple des concessionnaires de Pouembout » de Cynthia DEBIEN. « Une mairie dans la France Coloniale » de Benoît Trépied.
Ce texte a été rédigé avec le concours de l’Association « Raconte-moi Pouembout » qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la commune.
Mentions légales – 2019 © Mairie de Pouembout. Site réalisé par Push&Pull